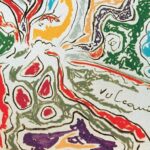En septembre 2022, après sa nette victoire aux élections législatives, la dirigeante de Fratelli d’Italia, la nationaliste Giorgia Meloni, s’est muée en européiste critique : elle a absorbé le discours (et le programme socio-économique) néolibéral de M. Mario Draghi, son prédécesseur, ancien directeur de la Banque centrale européenne (BCE). Et, dans le même mouvement, elle s’est détournée de M. Vladimir Poutine pour affirmer un atlantisme et un soutien à l’Ukraine sans faille.
Très présente au sein des institutions bruxelloises, elle cultive une complicité remarquée avec la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen. En dépit de sa situation financière dégradée, l’Italie figure au premier rang des États membres bénéficiaires de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) : plus de 190 milliards d’euros de prêts et subventions, alors que le pays est visé par une procédure européenne (1). En 2024, sa dette publique correspondait à 135 % du produit intérieur brut (PIB) et le déficit budgétaire à 3,4 % du PIB (2). Ainsi Mme Meloni peut-elle se présenter comme un rempart à l’orthodoxie et aux contraintes communautaires, dans une stratégie de double langage permanent (3).
Mais cette héritière du néofascisme — venue à la politique par les « jeunesses » de l’Alliance nationale (Alleanza nazionale, AN), créée en 1995 sur les cendres du Movimento sociale italiano (Mouvement social italien, MSI), lui-même fondé en 1946 par d’anciens dirigeants de la république de Salò — a aussi un projet politique explicite : faire triompher au Parlement européen son modèle national. « Nous voulons créer une majorité qui mette ensemble les forces du centre droit [c’est-à-dire la droite et l’extrême droite] et envoyer la gauche dans l’opposition, déclarait-elle il y a quelques mois. (…) Nous pouvons porter ainsi en Europe le modèle italien. Ce serait une révolution dans laquelle le rôle du parti des conservateurs est stratégique et fondamental » (La Repubblica, 28 avril 2024). À la tête d’une coalition qui regroupe droite traditionnelle (Forza Italia, la formation de feu Silvio Berlusconi) et extrême droite (la Lega Nord de M. Matteo Salvini), largement dominée par les Fratelli d’Italia, Mme Meloni espérait reproduire une entente du même type au Parlement de Strasbourg, afin de battre en brèche la sempiternelle cogestion socialistes – démocrates-chrétiens, renforcée, s’il y a lieu, par les Verts.
À la demande du patronat
Le résultat des élections européennes de juin 2024 ne l’a pas permis, mais le renversement d’alliance se concrétise ponctuellement. Pour contrecarrer le pacte vert pour l’Europe (ou Green Deal), le groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) a ainsi voté avec le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE), dont Mme Meloni était la présidente jusqu’à la fin de 2024. Et si elle a voté, avec les CRE, contre la reconduction de Mme von der Leyen en juillet 2024, celle-ci ne lui en a pas tenu rigueur et a accordé à l’Italie le portefeuille de vice-président chargé des politiques de cohésion régionale et des réformes, un poste important au sein de la Commission (4).
Le vent d’extrême droite qui souffle sur l’Europe et fait ployer une grande partie de la droite traditionnelle ne peut qu’encourager Mme Meloni à poursuivre sa stratégie continentale. Les conceptions qu’elle promeut ont influencé le pacte européen sur la migration et l’asile (avril 2024), qui durcit les conditions d’accueil et ouvre la voie à l’externalisation, à l’exemple du centre de rétention que Rome a fait installer à grands frais en Albanie — alors qu’en Italie la cheffe du gouvernement a répondu favorablement à la demande du patronat qui, en mal de main-d’œuvre, a obtenu la délivrance de 450 000 titres de séjour pour la fin de 2025. Des magistrats romains ont bloqué le projet d’externalisation, mais le pouvoir exécutif s’emploie à contourner leur décision pour le faire aboutir.
Au niveau national, la présidente du Conseil déploie aussi son dessein sur le terrain culturel, en menant une bataille contre la prétendue hégémonie de la gauche dans ce domaine, grâce à la construction d’un nouveau « récit national » (5) et en attaquant la Constitution de 1948. Les médias, comme l’enseignement et la culture, ont vocation à produire ce narratif. Le gouvernement a donc investi la RAI (Radiotelevisione italiana) à tous les niveaux de responsabilité. La lottizzazione (« lotisation »), c’est-à-dire le partage des médias publics entre forces politiques dominantes, est une pratique qui remonte aux années 1960. L’actuelle coalition vise, elle, un monopole. Des fidèles de Mme Meloni prennent la tête des principales institutions culturelles, avec le même mot d’ordre : valoriser le patrimoine et les racines chrétiennes de la nation. Le ministre de l’éducation et du mérite prépare ainsi un nouveau projet pédagogique qui veut notamment privilégier l’histoire de l’Italie, de l’Europe et de l’Occident « sans la surcharger de considérations idéologiques », redonner au latin un « rôle stratégique », encourager la lecture de la Bible et renforcer la connaissance « des racines de notre culture » (Il Giornale, 15 janvier 2025).
Mais sans doute est-ce la mise en cause des lois constitutionnelles qui révèle le mieux la nature du régime que Mme Meloni entend faire triompher. Il faut rappeler l’importance et l’originalité d’une charte fondamentale née au lendemain de la seconde guerre mondiale. Le texte garantit à la fois les libertés individuelles, collectives et la vocation des contre-pouvoirs. Ses pères fondateurs — en particulier les communistes, qui ont joué un rôle essentiel dans sa rédaction — voulaient prévenir le retour du fascisme. Mme Meloni a toujours refusé de reconnaître cette composante antifasciste d’une Constitution qui se distingue par son progressisme. « L’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail », dispose l’article premier. Gravés dans le marbre, le droit au travail et ses modalités, y compris le principe « à travail égal, salaire égal », ont servi de base à bien des combats émancipateurs.
Le gouvernement mène l’offensive sur quatre fronts principaux : l’élaboration d’un nouvel arsenal répressif, une réforme de la justice qui porte atteinte à l’indépendance de la magistrature, la mise en cause de la liberté d’informer, l’extension des pouvoirs de l’exécutif au détriment du Parlement et de la présidence de la République. Quatre domaines qui touchent aux garanties inscrites dans la Constitution de 1948. La réforme judiciaire prévoit ainsi la séparation des carrières entre procureurs et juges ainsi que la création de deux conseils de la magistrature distincts, ce qui pourrait se traduire par une dépendance du parquet à l’exécutif. Jusqu’ici, la carrière de tous les juges relève du Conseil supérieur de la magistrature et non du ministère de la justice.
Les manifestations de magistrats se multiplient contre ce projet, qui prévoit en outre l’abolition du délit d’abus de pouvoir et limite les possibilités d’écoutes téléphoniques décidées par un juge, afin de restreindre les capacités d’investigation dans des affaires impliquant le monde politique. En parallèle, le gouvernement entend criminaliser toute forme de dissidence. Les modifications à cette fin du code pénal — adoptées par décret-loi — introduisent vingt nouveaux délits et des peines aggravées : jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour le blocage d’une voie publique, de deux à sept ans pour l’occupation illégale d’un bâtiment, jusqu’à vingt ans pour les mouvements de protestation dans des centres de rétention ou de détention.
La liberté d’informer est également une cible. Les procédures judiciaires se multiplient contre la presse accusée de diffamation envers les autorités. Des tentatives d’intimidation s’exercent contre les lanceurs d’alerte. Et on a découvert récemment que les téléphones de certains journalistes étaient espionnés par le logiciel de la société israélienne Paragon Solutions, sous contrat avec le gouvernement italien.
Sur le plan politique, le projet le plus important de Mme Meloni — la « mère de toutes les réformes », dit-elle — vise à modifier la norme suprême pour concentrer le pouvoir dans les mains du gouvernement. En juin 2024, elle a fait adopter par le Sénat le premierato, réforme qui instaure l’élection du président du Conseil au suffrage universel et assure une forte majorité en sièges pour le parti arrivé en tête des votes. L’influence du président de la République (élu, lui, au suffrage indirect), traditionnellement garant des institutions — comme l’illustrent la pratique de l’actuel chef de l’État, Sergio Mattarella, et ses fréquents rappels à la loi fondamentale —, en ressortira amoindrie. Au nom de la stabilité, le premier ministre deviendrait ainsi tout-puissant. Au détriment du Parlement, du président, des partis, des syndicats et des contre-pouvoirs citoyens dont la Constitution de 1948 garantit le rôle jusqu’à maintenant. Faute d’une majorité des deux tiers au Parlement, ce projet fera sans doute l’objet d’un référendum.
Sur un plan sociétal, si le gouvernement ne peut s’en prendre directement à la législation qui autorise le droit à l’avortement, il multiplie les obstacles, déjà nombreux, à son accès. Ainsi, en vertu d’une loi sur l’objection de conscience de 1994, 63 % des gynécologues refusent de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Ce taux dépasse les 80 % dans certaines régions. Les associations anti-avortement peuvent quant à elles désormais intervenir au sein même des hôpitaux où se présentent les femmes qui demandent une IVG. La gestation pour autrui (GPA) avait déjà été proscrite il y a plus de vingt ans par Berlusconi. Mme Meloni en a fait un « délit universel » passible de deux ans d’emprisonnement et de lourdes amendes pour ceux qui la pratiqueraient à l’étranger. Enfin, la loi interdit qu’un enfant ait des parents du même sexe.
« Vice-régente de l’empire »
Madame Meloni a été la seule parmi les chefs de gouvernement européens à recevoir une invitation de la Maison Blanche pour la prise de fonctions du nouveau président. M. Donald Trump voit en elle une alliée privilégiée et une complice idéologique — dans le rejet du « wokisme » et de l’immigration, dans la défense des « valeurs chrétiennes »… L’arrivée au pouvoir de M. Trump a ouvert au moins deux perspectives. Soit Mme Meloni met à profit cette situation pour devenir la représentante des intérêts européens outre-Atlantique. Cela impliquerait qu’elle prenne des positions à équidistance de Washington et de Bruxelles ou, à tout le moins, susceptibles de la faire passer pour une conciliatrice potentielle. Mais un tel positionnement s’avère difficile quand les tensions s’exacerbent, et persévérer, comme elle le fait, dans la défense d’un atlantisme historique unissant Europe et États-Unis devient chimérique. Soit elle privilégie les rapports bilatéraux entre Rome et Washington, en tentant ainsi d’échapper à la vindicte anti-européenne du président américain. Mais elle apparaîtrait alors rapidement comme la « vice-régente de la province européenne de l’empire » (6). La fracture qui s’est ouverte entre les anciens alliés à propos de l’Ukraine comme de l’avenir de l’OTAN, sans parler de la guerre commerciale, rend encore plus hasardeuse cette stratégie.
Entre pragmatisme et détermination idéologique, l’habileté de Mme Meloni semble incontestable. Mais chaque jour apporte son lot de bouleversements et de provocations américaines : garder une position intermédiaire crédible entre Europe et États-Unis pourrait se révéler acrobatique. À moins que les choix géopolitiques opérés par M. Trump et la construction d’une Europe guerrière ne l’obligent à sortir de l’ambiguïté. Comme elle le fait dans son pays.