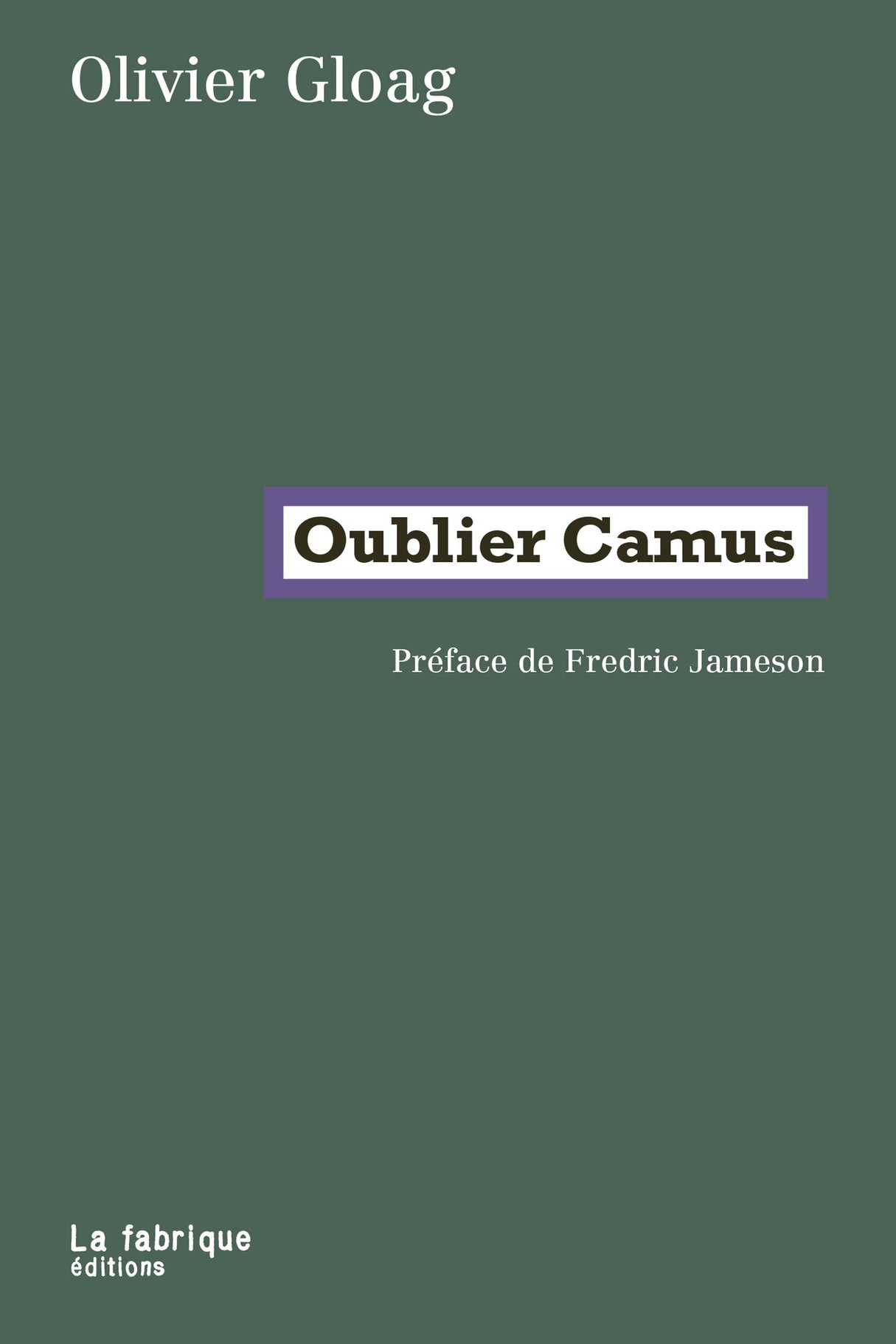Oblio, bugie e grandi eventi
3 Dicembre 2023
Henry Kissinger, War Criminal Beloved by America’s Ruling Class, Finally Dies
3 Dicembre 2023Dans son essai « Oublier Camus », l’auteur, professeur à l’université de Caroline du Nord, revient sur la représentation positive et souvent trompeuse que l’on fait, en France, des positions politiques du Nobel de littérature 1957.
Faut-il déboulonner les statues de certaines grandes figures de l’Histoire ? Ce débat se pose au sens littéral du terme. Dans Oublier Camus, Olivier Gloag, professeur de français et de culture francophone à l’université de Caroline du Nord (États-Unis), s’intéresse à la statue, au sens figuré, de l’écrivain français, Prix Nobel de littérature en 1957. Partant du constat qu’Albert Camus – né 1913 à Mondovi, en Algérie française, mort en 1960 – est omniprésent dans l’espace culturel français, Olivier Gloag propose une relecture de son œuvre.
Un regard critique – ni complaisant ni acerbe – sur ses prises de position, dans cet essai très documenté, où Gloag passe au crible livres, articles et correspondance de Camus. Il est aussi question de ses ambiguïtés sur la colonisation, de la peine de mort, de sa relation complexe avec Sartre… Ouvrage passionnant, Oublier Camus parle d’hier et d’aujourd’hui, à travers ce que l’on fait dire à l’écrivain. Il ne déboulonne pas sa statue, mais appose une plaque sur son socle pour situer le contexte politique de sa production littéraire et la portée de son héritage intellectuel.
Jeune Afrique : Quand avez-vous lu Albert Camus pour la première fois ?
Olivier Gloag : J’ai lu L’Étranger et La Peste au lycée. Puis, vers l’âge de 16 ou 17 ans, ma deuxième rencontre avec Camus s’est faite avec la chanson Killing an Arab, du groupe de pop The Cure. Quelqu’un m’a dit que les paroles reprenaient la trame narrative de L’Étranger. Ça a été un tel choc pour moi que je n’y ai pas cru, puis j’ai oublié cette anecdote. Quelques années plus tard, alors que je faisais mes études à New York, je suis tombé sur Culture et impérialisme, d’Edward Said, dans lequel un chapitre est consacré à Camus. J’ai voulu réécouter la chanson de The Cure, elle avait été rebaptisée Kissing an Arab…
Je cite l’introduction de Fredric Jameson, dans la préface d’Oublier Camus : « En lisant ce livre, vous constaterez que ses critiques visent moins Camus lui-même que sa canonisation mainstream. » Visez-vous l’œuvre, ou le regard que l’on porte sur Camus ?
S’il y a une cible, c’est bien la « réception » [la manière dont on comprend l’œuvre] de Camus. Ce n’est pas lui faire déshonneur que de le montrer tel qu’il était, un écrivain colonial, comme beaucoup d’autres écrivains français qu’on lit et qu’on apprécie. Il n’a dévoilé ses positions pro-coloniales que tardivement, en raison de la guerre d’indépendance du peuple algérien. La raison d’être de ce livre, c’est de montrer la manière béate et falsificatrice dont on lit Camus, qu’on idéalise. Camus jouait un double jeu, mais il était déchiré : il avait des aspirations de gauche, il venait d’un milieu défavorisé et il savait très bien que les Algériens étaient encore plus défavorisés que lui. Il avait non seulement une conscience de classe mais aussi la conscience qu’il y avait une ségrégation raciale dans l’Algérie française.
Ses écrits évoquent avec plus d’émotion le sort des colons victimes de contre-violences anticoloniales que celui des Algériens
Vous relevez ses réactions diffèrent selon que le sort frappe le colon ou le colonisé…
Oui, ses écrits évoquent avec plus d’émotion le sort des colons victimes de contre-violences anticoloniales que celui des Algériens. C’est le cas pour les massacres de Sétif, de Guelma et de Kherrata en 1945, et pour ceux de Madagascar en 1947. Cela fait-il partie de son inconscient colonial ? Le réfléchit-il ? La question reste ouverte, je ne tranche pas. En tout cas, ce n’est pas une position humaniste, à moins de penser qu’il y a différents types d’humanité.
Pourquoi Camus efface-t-il les Arabes dans son œuvre ?
Il y a de nombreuses interprétations possibles. Le critique nord-irlandais Conor Cruise O’Brien considère cet effacement comme un génocide littéraire. On peut aussi le voir comme l’espoir de la ratification d’un ordre colonial ou celui de ne pas à avoir à discuter du sujet. Dans L’Étranger, un colon est condamné à mort pour avoir tué un colonisé. C’est le fantasme d’une Algérie où il y aurait une véritable justice. Peut-être est-ce son souhait. Il s’inscrit dans un imaginaire qui veut résoudre les problèmes, d’une façon ou d’une autre.
« À partir du 19 novembre 1946, écrivez-vous, Camus rédige une série d’articles regroupés sous le titre “Ni victimes ni bourreaux”, dans lesquels il refuse de choisir entre la violence des colonisateurs et la contre-violence des colonisés […]. Cette position pacifiste et moralisante favorise le statu quo : elle vise à maintenir une situation où l’ordre colonial ne risquerait pas d’être menacé par une insurrection populaire ». L’œuvre littéraire de Camus est-elle une justification de la colonisation ?
Ce n’est pas le but de l’œuvre littéraire de Camus, mais elle ratifie son existence et elle permet de l’idéaliser. De nombreux commentateurs prétendent que L’Étranger est une critique du système colonial. Peu d’éléments justifient ce propos. Camus et ses œuvres ont été récupérés pour réécrire l’Histoire et donner une image de la France à la fois coloniale et humaniste.
Vous écrivez que ses états de service en tant que résistant ont été surévalués…
Camus rejoint la résistance à la fin de 1943, ou au début de 1944, selon les sources. Dans Lettres à un ami allemand, il parle des raisons du retard de la France à entrer dans la résistance et de son propre retard. Il s’est d’abord conformé à sa théorie de l’absurde, il était dans une phase nihiliste. L’absurde est une théorie du non-engagement. Même avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Camus était pour les accords de Munich. Cette position était courante, en France, même à gauche de l’échiquier politique. En disant cela, je ne le juge pas. Mais, dans La Pléiade, des textes rédigés par des sommités de l’université affirmaient qu’il était entré dans la résistance durant l’été 1942 ou en mars 1943.
Dans un article écrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il dit : « Il n’est pas question d’épurer, il est question d’épurer bien. » Camus a aussi refusé de soutenir les demandes de grâce de condamnés à mort pendant la guerre d’Algérie. Il n’était-il donc pas l’anti-peine de mort qu’on nous décrit…
Certains livres sur Camus le décrivent comme un pourfendeur de la peine de mort, ce qui n’est pas conforme à la réalité de ses prises de position, changeantes. Camus était pour l’épuration, puis il s’est joint à la demande de grâce destinée à sauver [les écrivains] Robert Brasillach et Lucien Rebatet. Il publie son essai Les réflexions sur la guillotine au moment où Fernand Iveton est condamné à mort, puis exécuté, mais il ne se joint pas aux demandes de grâce. Gisèle Halimi écrit que Camus refusait d’aider certains militants du FLN. Il n’avait pas une position abolitionniste.
Quand il parle de terroristes, il parle de certaines actions du FLN, mais il ne parle pas, par exemple, de l’attentat de la rue de Thèbes, que la police coloniale a perpétré
Vous écrivez d’ailleurs : « L’opposition de Camus à la peine de mort est conditionnelle : il ne veut pas intervenir pour ceux qu’il considère comme terroristes »…
Quand il parle de terroristes, il parle de certaines actions du FLN, mais il ne parle pas, par exemple, de l’attentat de la rue de Thèbes, que la police coloniale a perpétré de façon clandestine et qui a fait des dizaines de morts en pleine Casbah. Il a assimilé une hiérarchie des valeurs : d’une part, certaines violences de l’État ou des colons français sont de la force – donc conçues par lui comme légitimes – et, d’autre part, la contre-violence des colonisés est condamnable.
Comment les œuvres de Camus et de Sartre dialoguent-elles à travers les époques ?
Dans sa première critique sur La Nausée, Camus affirme que ce n’est pas vraiment un roman, mais plutôt une discussion philosophique. Il espère que le ton sera moins professoral la fois suivante. Sartre répond dans Explication de L’Étranger. Six mois plus tard, Camus écrit la genèse de ce qui sera L’Homme révolté, Sartre se moque de ses prises de position dans sa pièce Les Mains Sales. Il emploie un ton provocateur et paternaliste. Dans La Chute, le personnage principal, Jean-Baptiste Clamence, peut être considéré, selon moi, comme un double de Sartre et de Camus. Clamence est décrit comme un « juge pénitent ». Le juge s’engage et ce serait Sartre ; le pénitent regrette ses erreurs, ce serait Camus. À la fin de l’histoire, le juge et le pénitent ont tort.
« Oublier Camus tel qu’on nous le présente, c’est également permettre de jeter un regard plus lucide sur les faux-semblants d’une certaine gauche qui masque insidieusement son racisme et son impérialisme […], cette gauche dont Camus est devenu l’un des emblèmes », écrivez-vous. Qui représente aujourd’hui, en France, la gauche camusienne et la gauche sartrienne ?
Prenons pour exemple les intérêts français au Niger. Ce pays n’a presque pas d’électricité, et pourtant, au moins 10% de l’électricité française est produite grâce à son uranium. On est bel et bien dans un colonialisme « extractif », mais on peut s’en dédouaner car aucun drapeau français n’est planté sur le sol de ce pays. Qui critique cette Françafrique ? Presque personne.
On ne discute pas du néo-colonialisme, qui est à l’origine du niveau de vie élevé de la France, et on parle encore moins de sa genèse, qui passe par le Code Noir, par les réparations que le peuple haïtien a dû payer, etc. Il faut remettre ce volet historique sur le devant de la scène. On ne peut pas parler d’immigration sans parler d’impérialisme. Dès que l’on prône le rétablissement de ces faits historiques, les critiques dénoncent le wokisme ou la cancel culture – deux mots inventés par la droite extrême américaine, et dont le recyclage dans le débat français prouve que l’Histoire est perçue par les élites françaises comme une menace de mort. Y a-t-il un parti qui tente de répondre à ces questions ? Oui, certaines voix au sein de La France insoumise [LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon].
Vous évoquez les différences entre les deux éditions, l’une algérienne et l’autre française, de Meursault, contre-enquête, de Kamel Daoud. Qu’est-ce que cela prouve ?
J’ai lu l’édition française, publiée chez Actes Sud, puis l’édition algérienne, publiée chez Barzakh. J’ai été très surpris car les changements ne concernent pas seulement la quatrième de couverture. La version publiée chez Barzakh est beaucoup plus critique sur Camus. Il y a un amalgame entre Camus et Meursault ; Daoud parle du moment où le personnage est allé à Oran et qu’il a tenté de commettre un génocide. Ces passages disparaissent dans la version française, ce qui montre que Daoud a bien compris que Camus est un intouchable pour les élites françaises. Pourtant, même dans cette version édulcorée, Meursault, contre-enquête a été un petit choc au départ.
Dire que Camus est un écrivain colonial ne préjuge pas de la qualité littéraire de ses textes.
Que nous disent les positions des intellectuels français sur Sartre et Camus ?
Avec Plaidoyer pour les intellectuels, Sartre explique qu’un intellectuel doit se mêler de ce qui ne le regarde pas, avoir le courage de parler contre ses intérêts de classe et, si besoin, contre les intérêts de sa patrie. Mais, par exemple, Bernard-Henri Lévy a soutenu l’intervention militaire de la France en Libye. La dérive vers l’extrême-droite de Michel Onfray remonte à son livre sur Camus, où il prétend que celui-ci a été anticolonialiste toute sa vie. Les intellectuels médiatiques, comme Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann, se situent dans un mouvement anti-communiste virulent, qui épouse les intérêts de leur propre classe sociale. Un rapport de la CIA des années 1980, déclassifié, se réjouit de l’influence de Bernard-Henri Lévy et du fait que Sartre n’ait pas eu de successeurs !
Camus est-il un grand écrivain, malgré ses positions coloniales ?
Il n’y a aucun lien entre un positionnement politique et la qualité d’une œuvre littéraire. Dire que Camus est un écrivain colonial ne préjuge pas de la qualité littéraire de ses textes. De même, avoir un point de vue critique ne signifie pas être un procureur. Il n’est pas question d’affirmer que tous les auteurs qui sont d’accord avec moi sont de bons auteurs, et inversement.
L’Étranger est un texte extraordinaire parce que voilà un nouveau type de héros, un bureaucrate sans aucune ambition sociale, et qui est un reflet du colonialisme français. Il faut absolument continuer de lire et d’enseigner ce roman, qui nous explique l’ambiguïté profonde de la gauche française, qui se veut progressiste mais qui ne peut pas admettre que, si le niveau de vie la France est aussi élevé aujourd’hui, c’est grâce à l’oppression coloniale.
Caligula est une grande pièce de théâtre, de loin la meilleure de Camus, qui explore l’absurde. Noces à Tipasa montre les acquis sociaux du Front Populaire, un nouveau rapport à la nature d’une France ouvrière, qui peut la découvrir, faire du vélo, etc. Ces trois textes, écrits quand il était en Algérie, sont des chefs d’œuvre. Camus est malgré tout un grand écrivain.
Oublier Camus, d’Olivier Gloag, La Fabrique Éditions, 160 p., 15 euros.