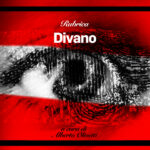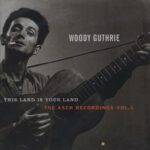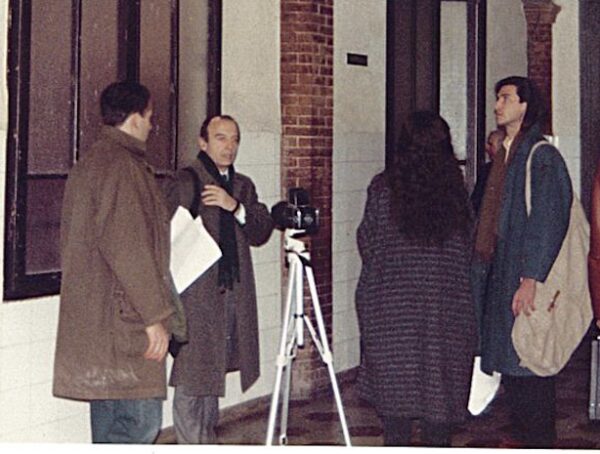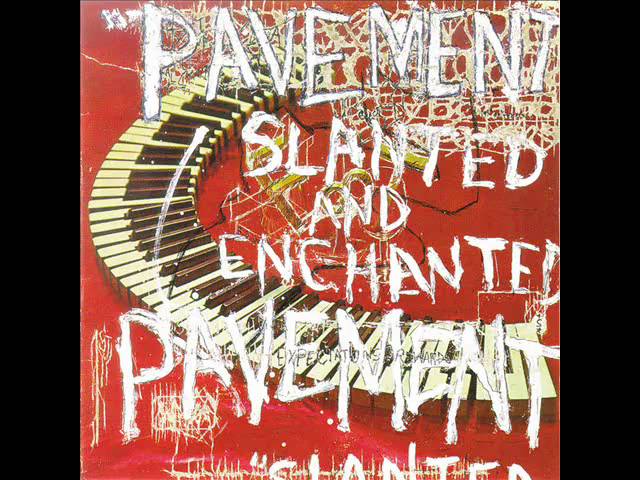Interrogé par la Tribune-dimanche le 16 mars (1), John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale du gouvernement Donald Trump I, qui qualifie son ancien patron de « personnage aberrant qui cause des dégâts tous les jours », craint une probable « finlandisation » de l’Ukraine, après que Trump, « au lieu d’aider un pays victime, se soit rangé du côté de l’envahisseur ». Son refus d’offrir des garanties de sécurité à l’Ukraine donne à Poutine, dit-il, « l’impression d’avoir le champ libre ».
Guillaume Ancel, ancien officier, auteur récemment d’une « Petite leçon sur la guerre — comment défendre la paix sans avoir peur de se battre » (Éditions Autrement, 2025), estime qu’un éventuel cessez-le-feu reviendra à concéder définitivement un cinquième du territoire ukrainien à la Russie, ainsi que l’interdiction pour l’Ukraine de rejoindre le club de défense qu’est l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), comme cela a été conclu en sous-main depuis la mi-février : « Poutine a besoin de cette victoire pour le 9 mai 2025 – pour les quatre-vingtièmes commémorations de la grande victoire de l’URSS contre le nazisme »
Les analystes du think tank d’ex-militaires La Vigie considèrent, dans un article du 16 avril, que, l’air de rien, une « grande stratégie » est à l’œuvre : renouant avec un « isolationnisme agressif », Donald Trump, en s’offrant ainsi à Vladimir Poutine — ancien épouvantail de l’Amérique démocrate, mais aussi républicaine à l’ancienne — cherche d’abord à écarter la Russie de la Chine (comme Kissinger avait tenté, en se rapprochant en 1972 de Pékin, d’écarter la Chine de l’Union soviétique).
Le président américain semble même, selon La Vigie, envisager une réelle alliance commerciale avec le Kremlin : « Il est intéressé par les matières premières de la Russie et de son rivage arctique, mais aussi par son influence au Proche-Orient ». Est-ce grâce à l’aide de Moscou, que Trump a pu par exemple entamer ces jours-ci avec Téhéran une négociation quasi directe — et plutôt inattendue — sur le nucléaire iranien ?
Effet calmant ?
Même si c’est moins dans l’air du temps ces jours-ci, va-t-on vers une troisième guerre mondiale ?
Thierry de Montbrial, le président de l’Institut français des relations internationales (IFRI), auteur de « L’ère des affrontements – Les grands tournants géopolitiques » (Dunod, 2025), affirme que ce risque existe. Le retour de la guerre en Europe n’en a été que le prélude : on revient au tragique de l’histoire, après les rêves de paix perpétuelle. Le géopoliticien Frédéric Encel est persuadé du contraire : « La guerre mondiale n’aura pas lieu », titre son dernier ouvrage (Odile Jacob, 2025). Selon lui, il y a « des raisons géopolitiques d’espérer » et la dissuasion — pas seulement nucléaire — reste la plus forte. Même s’il brandit régulièrement le spectre de « l’apocalypse », même s’il est assurément brutal, Vladimir Poutine n’est pas suicidaire — pas plus que la plupart des acteurs à l’échelle planétaire. Quant à Donald Trump, son imprévisibilité, qu’elle soit organisée ou chaotique, a un effet « calmant » sur ses adversaires : face à l’incertitude, ils sont contraints d’agir avec plus de retenue, estime Encel.
Après trois ans de guerre ouverte en Ukraine, en plus des destructions tous azimuts, les dégâts humains sont énormes.
Le secret est de rigueur en ce qui concerne les pertes militaires des deux bords. Du côté de l’armée de Kiev, le Wall Street Journal, au terme d’une enquête publiée le 17 septembre dernier, dressait un bilan à la mi-2024 de 80 000 morts et 400 000 blessés. En février dernier, le président Zelenski avait évoqué publiquement un chiffre de 46000 tués et 380000 blessés. L’armée russe communique encore moins que les Ukrainiens. Le service russe de la BBC, à Londres, retient le chiffre de 91 000 soldats tués, au moins. Des agences occidentales de renseignement évoquent des estimations allant parfois jusqu’à 200 000 morts et 400 000 blessés — résultat notamment d’une politique délibérée de la « chair à canon », avec l’emploi dans certaines secteurs d’unités spécialisées dans des assauts répétés.
Sacrifice inimaginable
Début janvier, devant des élèves-officiers de son pays, l’attaché militaire adjoint allemand à Kiev pointait ce qu’il appelle le « sacrifice inimaginable des soldats russes ». Leur armée aurait perdu jusqu’à un millier d’ hommes par jour — tués ou blessés — à certaines périodes l’an dernier, du fait d’une stratégie qui mise sur une ressource humaine supposément infinie. Elle a reposé au début sur l’emploi de prisonniers ou de miliciens grâce à des primes ; désormais, les centres de recrutement visent notamment les migrants d’Asie centrale en situation irrégulière — Ouzbeks, Tadjiks, Kirghizes —, leur faisant miroiter un accès à la citoyenneté russe. Les jeunes Russes recrutés lors des campagnes annuelles de conscription, au printemps, ne rejoignent pas forcément le front : la vague de 2025, tout juste décidée par décret présidentiel, concerne un effectif de 160 000 hommes et femmes — la plus étoffée depuis une quinzaine d’années.
Si les pertes civiles en Russie du fait de la guerre avec Kiev sont négligeables, l’Ukraine déplorerait, selon plusieurs organisation non gouvernementale (ONG), au moins 42 500 civils morts ou blessés depuis le déclenchement de la guerre en février 2022, avec une intensification très nette ces derniers mois des bombardements et des tirs d’obus (2). Ces ONG, parmi lesquelles Oxfam et Handicap International, dénoncent « l’utilisation généralisée de drones et l’usage disproportionné de missiles balistiques dans des zones peuplées », avec recours à des secondes voire troisièmes frappes, et à des projectiles à sous-munitions — pratiques en principe interdites (3).
Cette hécatombe a des conséquences démographiques : bien qu’en recul constant (4) depuis plusieurs dizaines d’années, la population de la fédération de Russie compte encore 143 millions d’habitants — un vivier dans lequel puise l’armée. En revanche, la population ukrainienne, qui était de 41 millions en 2022, n’atteindrait plus que 25 à 27 millions, du fait d’une émigration massive, d’un taux de natalité également faible, des pertes au combat, etc. En avril 2004, le Parlement ukrainien avait dû abaisser de 27 à 25 ans l’âge de la conscription dans l’armée, pour regarnir les rangs ; mais les classes d’âge plus jeunes sont restées préservées. Corollaire : la moyenne d’âge des combattants ukrainiens est élevée, les permissions et relèves sont insuffisantes, comme les formations ou entraînements.
Armée invisible
L’usure de l’armée ukrainienne est aussi matérielle. Selon Volodymyr Zelensky, un tiers environ de l’équipement militaire de son armée est fabriqué en Ukraine, devenue championne dans la mise au point et la production de drones (1,5 million en 2024) ou d’obus (2,5 millions de pièces en 2024), combinant innovation, rapidité, et coûts modérés. Mais l’armée ukrainienne doit compter avec un équipement disparate, ex-soviétique ou ex-occidental, et en trois ans, elle a essuyé des pertes majeures (par exemple, une trentaine de chars Leopard détruits sur la centaine confiés par plusieurs pays européens). En outre, l’emploi des petites escadrilles de chasseurs F-16 de fabrication américaine rétrocédés par certains pays européens pourrait être remis en question par les États-Unis, qui peuvent également suspendre à nouveau leurs livraisons d’armes et leur couverture en matière de renseignement, comme ils l’ont déjà fait en mars dernier, contribuant à la reprise par les soldats russes du territoire conquis par l’armée ukrainienne dans la région de Koursk. Un point fort, cependant, pour l’armée de Kiev : le soutien d’une « armée invisible de volontaires », qui n’a pas d’équivalent côté russe.
De combien de temps aura besoin la Russie pour reconstituer ses forces ?
Très affaiblie par son offensive le long du front ukrainien d’un millier de kilomètres, l’armée russe devra retrouver un potentiel militaire largement entamé. La fuite à l’étranger d’une partie des jeunes mobilisables, l’invraisemblable équipée d’Evgueni Prigojine et de ses mercenaires de Wagner, marchant vers Moscou en août 2023, ou la valse des ministres et généraux de l’ex-armée rouge en Ukraine sont pour le moins les signes d’un malaise. Mais Vladimir Poutine veut consacrer un tiers de la dépense publique au budget militaire, avec un plan de réarmement à l’horizon 2030 ; la mobilisation de l’appareil industriel russe — dans le cadre d’une véritable « économie de guerre » pour le coup — lui laisse espérer un rétablissement des stocks d’armes et munitions dans deux à trois ans, ainsi qu’une reconstitution de la « ressource humaine ». Un délai que certains des pays s’estimant les plus exposés face à la Russie — États baltes, Finlande, Suède, Pologne, Roumanie — veulent mettre à profit pour renforcer massivement leurs moyens de défense.
Changement de régime
La question des garanties va occuper longtemps les débats et négociations. L’Ukraine en demande sous forme du maintien de l’aide militaire étrangère, et du déploiement de troupes internationales aux futures frontières. Français et Britanniques, à la tête d’une « coalition de volontaires », en ont accepté le principe. Washington ne veut pas d’implication militaire, et se contenterait d’accords économiques, pour se faire rembourser ce qu’il estime être une « dette » de l’Ukraine à l’égard des États-Unis. Moscou ne veut ni des Européens, ni d’autres troupes à ses frontières, et exige même, outre la partition, la démilitarisation de l’Ukraine — soit dans la pratique un changement complet de régime à Kiev (et la peau de Zelensky).
Les Européens pourront-ils se substituer aux Américains, si ces derniers s’avèrent défaillants dans leur aide à l’Ukraine ?
Ursula von der Leyen, cheffe de l’exécutif européen, a rappelé — lors de la 61e Conférence de Munich sur la sécurité le 14 février dernier — que le soutien total de l’Union européenne à l’Ukraine se chiffrait globalement à 134,9 milliards d’euros en 2025, sous des formes diverses (dons, prêts, subventions, soutien militaire, etc.). Soit plus de la moitié de l’aide mondiale reçue par le pays (267 milliards d’euros). Une contribution qui dépasse nettement celle des États-Unis (114 milliards d’euros), selon les dernières données du Kiel Institute, un organisme de recherche économique basé en Allemagne. Il faut y ajouter le nouveau plan proposé par Bruxelles — un éventail de leviers de financement, qualifié par ses concepteurs « d’omnibus défense » : sur les 800 milliards d’euros évoqués, 650 correspondent à un feu vert donné aux États pour un dépassement des fameux 3 %, considérés jusqu’ici comme un déficit maximum autorisé en temps normal. À quoi s’ajoute un fonds de 150 milliards d’euros baptisé Security Action for Europe (Safe, Action de sécurité pour l’Europe)), qui prêtera aux États souhaitant financer des programmes d’armement au moins européens à 65 %, et présentant des garanties de conception autonome.
Mauvais génie
L’Allemagne a été le principal soutien financier de l’Ukraine, depuis l’invasion par les troupes russes : 17,2 milliards d’euros. Le second gros contributeur de l’UE est étonnamment le Danemark (8 milliards), suivi des Pays-Bas (7,3) et de la Pologne (5). Selon le Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), au moins 35 pays ont envoyé des armes vers l’Ukraine ces dernières années, avec, au premier rang, les États-Unis (42 % des armes importées par l’Ukraine), devant l’Allemagne (12 %) et la Pologne (11 %). Le soutien de la France est d’un montant plus modeste — 4,8 milliards sur trois ans — mais surtout politique, comme s’en félicitent les Ukrainiens, très demandeurs d’appuis diplomatico-militaires, et s’en agacent les Russes, persuadés que Paris est le « mauvais génie » de Kiev dans ce conflit, et cherche à y impliquer l’Europe entière. D’après Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN, la production européenne d’armement reste « largement inférieure » à celle de la Russie, qui fabrique plus de munitions en trois mois que l’Europe en une année.
Les équilibres traditionnels européens seront-ils rompus ?
L’Allemagne, « orpheline du protecteur américain » — Voir la série de reportages du Monde à partir du 25 mars 2025 : « Les Européens, la guerre et la paix » — semble, en avoir fini avec le pacifisme qui lui a été imposé depuis la fin de la seconde guerre mondiale : conservateurs, sociaux-démocrates et verts allemands ont adopté à plus des deux tiers des voix au Bundestag ce que le futur chancelier Friedrich Merz appelle « le premier grand pas vers une nouvelle communauté européenne de défense », avec la levée des freins traditionnels à l’endettement et la création d’un fonds spécial de 500 milliards d’euros disponible sur douze ans, baptisé le plan « bazooka ».
L’ex-président du conseil européen et ex-premier ministre italien, Romano Prodi, rappelle dans Marianne (27 mars) que « l’Allemagne deviendra le pays le plus fort dans le domaine de la défense d’ici sept à huit ans ». D’autres observateurs font valoir qu’après plus de dix ans de pratique guerrière, l’Ukraine, si elle n’est pas neutralisée après sa défaite face à l’envahisseur, sera une puissance militaire importante — la plus étoffée, aguerrie, inventive, etc — même si elle doit rester en marge de l’OTAN. Et que par ailleurs, il faudra compter à l’avenir avec l’armée polonaise, qui va connaître une croissance record : aux premières loges (car frontalière de la Russie et de la Biélorussie comme de l’Ukraine sur 600 km), elle ambitionne de consacrer 5 % de son produit intérieur brut (PIB) à sa défense cette année, avec l’objectif d’une armée à 500 000 hommes dans deux ou trois ans (contre 200 000 actuellement). Londres et Paris n’auront alors plus le monopole de la puissance militaire en Europe…
Les reportages de cette même série du Monde, montrent que les opinions en Hongrie bien sûr, mais aussi en Italie ou en Espagne, sont plus rétives face à ces perspectives d’engagement sans issue visible en Ukraine et de réarmement tous azimut. « Je n’aime pas le mot réarmement. Il ne me plaît pas du tout », a même déclaré le 20 mars dernier à Bruxelles le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a obtenu que le plan de plan européen soit renommé « Être prêts pour 2030 », et plaidé pour y inclure la cybersécurité, la lutte contre le réchauffement climatique, etc (5).
Ordre dispersé
La confiance est-elle rompue au sein de l’OTAN, ouvrant un espace pour une « Europe de la défense » qui n’a jamais vraiment existé ?
La certitude d’une couverture stratégique américaine en cas d’attaque contre un pays européen (la Russie contre les États baltes, la Turquie contre la Grèce, etc.) n’existe plus. En tout cas, son automaticité. Certains pays en ont tiré les conséquences, effectuant un revirement historique, comme l’Allemagne ou le Royaume uni, deux ex-champions de la relation transatlantique. Pour Romano Prodi, « Vladimir Poutine n’aurait jamais attaqué l’Ukraine si l’Europe — 17 % du PIB mondial, autant que la Chine — avait eu une défense commune ». Mais, « divisés, nous ne sommes rien », admet Prodi.
Du côté de La Vigie, on s’en tient à une vision moins optimiste : « Pour la quasi-totalité des Européens, la question stratégique première demeure la préservation du lien transatlantique, beaucoup plus importante que l’autonomie stratégique européenne, sans même parler du sort de l’Ukraine. Les uns et les autres vont ainsi se présenter en ordre dispersé à Washington. Chacun a compris que la prime d’assurance venait de doubler. Les discours sur l’augmentation des dépenses de défense prennent prétexte de la menace russe pour justifier l’achat de plus d’armes, qui seront américaines, n’en doutez pas. Le sommet de l’Alliance à La Haye en juin le dira » (6).
Pour l’heure, les pays européens sont encore largement dépendants des États-Unis : selon le Sipri, les deux tiers du matériel militaire importé ces dernières années par les pays européens proviennent de firmes américaines. Washington profite donc largement du réarmement qu’il a conseillé, voire exigé de ses partenaires de l’OTAN. Après quatre décennies à profiter des « dividendes de la paix », avec des effectifs militaires réduits et des capacités limitées, l’Europe pourra-t-elle, en quelques années, reconstituer son potentiel militaire, tout en uniformisant les matériels utilisés par ses armées — la fameuse « interopérabilité » qui est une des fonctions principales de l’actuelle OTAN —, et surtout coordonner, voire mettre en commun ses moyens ? Tous les pays ne pourront espérer posséder des panoplies militaires complètes, et devront se reposer sur les spécialités de leurs partenaires européens possédant un savoir-faire incontestable par exemple dans le parachutage, les interventions amphibie, les plongées profondes, le renseignement satellite, etc.