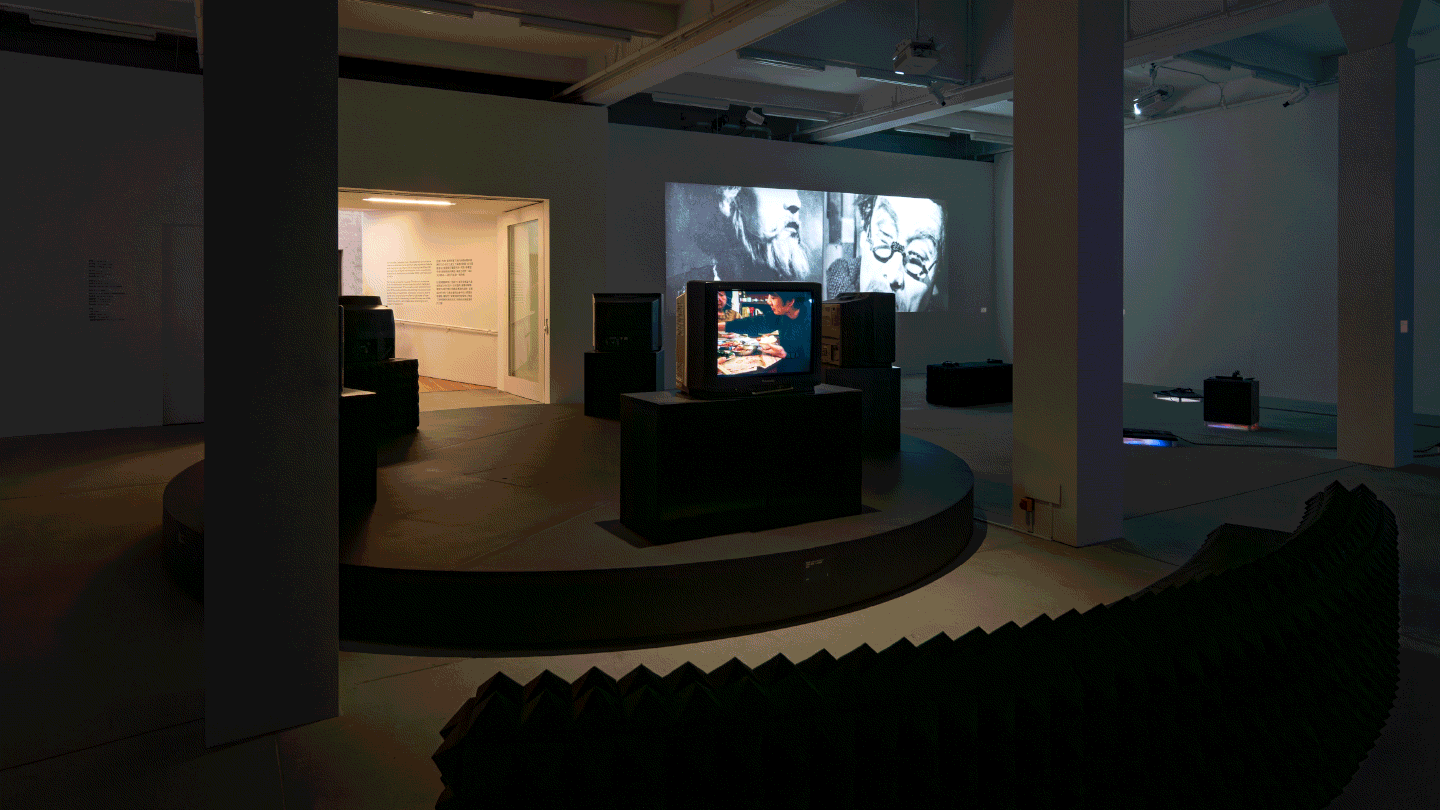Àla fin avril 2017, un certain nombre d’élus républicains du Congrès américain ont créé un groupe (caucus) baptisé « Israel Victory » (1). « Nous croyons, disent-ils, qu’Israël est victorieux dans la guerre et que ce fait doit être reconnu si on veut aboutir à la paix entre Israël et ses voisins. » Il faut, explique l’un de ses membres, l’universitaire Daniel Pipes, qu’Israël « impose sa volonté à l’ennemi ». Comme en écho, plusieurs centaines de prisonniers politiques palestiniens déclenchent une grève de la faim à l’appel du plus connu d’entre eux, M. Marouane Barghouti — leur manière de proclamer haut et fort que la résistance continue et que les illusions sur leur anéantissement se dissiperont une fois de plus. Car ce n’est pas la première fois qu’Israël et ses alliés fantasment sur la capitulation, voire sur la disparition, des Palestiniens.
« Les réfugiés trouveront leur place dans la diaspora. Grâce à la sélection naturelle, certains résisteront, d’autres pas. (…) La majorité deviendra un rebut du genre humain et se fondra dans les couches les plus pauvres du monde arabe (2). » Influent dirigeant sioniste travailliste, futur premier ministre d’Israël, Moshe Sharett prophétisait, au lendemain de la guerre israélo-arabe de 1948-1949, le funèbre avenir des 700 000 Palestiniens expulsés de leurs foyers.
Ceux-ci venaient de subir une lourde défaite, le territoire prévu pour leur État par le plan de partage des Nations unies, voté le 29 novembre 1947, se voyant divisé en trois : une partie (notamment le nord de la Galilée) conquise par Israël ; la Cisjordanie et Jérusalem-Est annexés par le royaume hachémite de Jordanie ; et enfin un petit territoire, Gaza, passé sous contrôle égyptien, avec une certaine autonomie. Leurs institutions ayant sombré dans la tourmente, ils se retrouvaient sans direction politique.
Naissance d’un mouvement de libération
Cette catastrophe (nakba en arabe) faisait suite à une autre déroute : l’écrasement de la grande révolte palestinienne de 1936-1939 — une insurrection civile et militaire exigeant la fin de la présence britannique et l’arrêt de l’immigration juive. Ce soulèvement fut réprimé par les troupes de Sa Majesté alliées aux milices armées sionistes, ces dernières acquérant dans les combats les armes (fournies par Londres) et les compétences qui permirent leur victoire face aux armées arabes en 1948-1949.
Relégués sous des tentes dans les pays limitrophes ou demeurés sous contrôle israélien, les Palestiniens semblaient appelés à disparaître, comme le prédisait Sharett. Leur sort s’apparenterait à celui des Peaux-Rouges ou à celui des populations « autochtones » exterminées lors des conquêtes de l’Amérique du Nord, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Ou encore ils se dissoudraient dans un environnement arabe propice : ne parlaient-ils pas la même langue, ne partageaient-ils pas la même culture, souvent la même religion, que les populations qui les accueillaient ?

Israël dénonça le refus des pays arabes d’assimiler ou même d’intégrer les réfugiés. Pourtant, ce furent les Palestiniens qui rejetèrent toute tentative d’implantation dans les pays d’accueil — leur premier acte de résistance. Ils repoussèrent même, dans un premier temps, l’idée de construire en dur dans les camps où ils étaient parqués. À Gaza, alors que le nouveau pouvoir égyptien des Officiers libres, dirigé par Gamal Abdel Nasser, signait en juillet 1953 un accord avec l’UNRWA (3) prévoyant l’installation dans le Sinaï de dizaines de milliers de réfugiés, de violentes manifestations palestiniennes refusèrent cette forme d’implantation. Le retour restait le seul rêve acceptable.
Le militant pacifiste israélien Uri Avnery a rapporté cet éclairant dialogue durant la guerre de 1956 (4) et la première et courte occupation israélienne de Gaza, alors qu’il était soldat : « J’avais interrogé un garçon arabe vivant dans un camp de réfugiés : “D’où es-tu ?”, lui avais-je demandé. “D’Al-Koubab”, avait-il dit. J’avais été frappé par cette réponse… parce que ce garçon était âgé de 7 ans. Il était donc né à Gaza après la guerre et n’avait même pas vu Al-Koubab, un village qui avait cessé d’exister depuis longtemps (5). » Soixante ans plus tard, alors que la majorité des Palestiniens est née en exil, les réponses des enfants comme des adultes restent les mêmes : ils appartiennent au village d’où leur famille a été expulsée. Le mouvement sioniste, qui a fait d’une prière vieille de plusieurs milliers d’années (« L’an prochain à Jérusalem ») un mot d’ordre politique, devrait comprendre cet attachement.

C’est sur cette détermination au-delà de la défaite que devait se reconstruire le mouvement national palestinien après la Nakba. Le contexte régional y contribua. La création d’Israël ébranla le Proche-Orient et accéléra l’écroulement des régimes arabes pro-occidentaux. On assista à l’accession de Nasser au pouvoir en Égypte en 1952, à la montée d’un nationalisme révolutionnaire dans toute la région, à la chute de la monarchie en Irak en 1958. Cette effervescence ainsi que la rivalité et la surenchère entre les pays arabes soucieux d’effacer le souvenir d’une humiliante défaite face à Israël aboutirent à une décision de la Ligue arabe : la création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1964. Parallèlement, une organisation jusque-là inconnue, le Fatah, lança ses premières opérations armées contre Israël le 1er janvier 1965. La nouvelle débâcle arabe de juin 1967 (6) créa les conditions d’une autonomisation de la lutte palestinienne. Le 1er février 1969, le chef du Fatah, Yasser Arafat, était élu président du comité exécutif de l’OLP.
Le mouvement national palestinien s’installait dans un paysage international marqué par la lutte des peuples d’Indochine contre l’intervention américaine, les guérillas en Amérique latine, l’émergence des mouvements armés contre le colonialisme portugais et contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud. L’écrivain Jean Genet, dans Un captif amoureux (1986), résumait ces rêves : la Palestine était au cœur d’« une révolution grandiose en forme de bouquet d’artifice, un incendie sautant de banque en banque, d’opéra en opéra, de prison en palais de justice ».
Cet espoir fit long feu. Empêtrés dans les conflits internes libanais, visés par les opérations israéliennes dans les territoires occupés comme au Liban, victimes des divisions du monde arabe et des ingérences de certains des pays de la région (Irak, Syrie, Jordanie) dans leurs affaires, les Palestiniens durent se replier sur des objectifs plus limités et une acceptation de l’idée de partage de la Palestine. Renonçant petit à petit à la lutte armée et aux « actions extérieures », notamment les détournements d’avions, qui firent connaître leur cause dans le monde entier et que les États occidentaux qualifiaient de « terroristes », ils s’engagèrent dans l’action diplomatique et politique, dans la construction d’institutions plus ou moins stables (organisations de jeunesse, de femmes, syndicats, union des écrivains, etc.).
Un sentiment de supériorité à l’égard des « indigènes »
S’appuyant notamment sur la mobilisation grandissante des populations de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, occupés en 1967, l’OLP conquit une stature internationale ; Arafat fut invité à intervenir à l’Assemblée générale des Nations unies le 13 novembre 1974. L’OLP fut alors reconnue par la grande majorité des États, à l’exception d’Israël et des États-Unis, ces derniers attendant les années 1990 pour changer de position. L’Europe et la France contribuèrent, dans les années 1980, à faire entériner deux principes : le droit des Palestiniens à l’autodétermination et la nécessité d’un dialogue avec leur représentant, l’OLP.
Il fallut encore l’Intifada, qui éclata en décembre 1987, et la fin de la guerre froide pour aboutir aux accords d’Oslo, signés à Washington le 13 septembre 1993 entre Yasser Arafat et Itzhak Rabin, le premier ministre israélien, sous le parrainage du président américain William Clinton. Le 1er juillet 1994, Arafat installa, à Gaza et Jéricho d’abord, l’Autorité palestinienne. En principe, le flou des textes signés devait être compensé par la reconnaissance d’un principe clair : l’échange de « la paix contre les territoires », la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël, dans les frontières du 4 juin 1967. On le sait, ce « processus de paix » déboucha sur un échec patent. Malgré l’« autonomie » octroyée, la vie quotidienne des Palestiniens se détériora ; les difficultés de déplacement se multiplièrent en même temps que les barrages militaires. La colonisation progressa inexorablement, sous les gouvernements israéliens de gauche comme de droite.

On peut disserter sur les diverses explications de cet échec, mais la principale porte sur le caractère colonisateur de l’entreprise sioniste. Celle-ci a nourri un sentiment de supériorité vis-à-vis des populations « indigènes », qui pousse les dirigeants israéliens à refuser de reconnaître aux Palestiniens, dans les faits, l’égalité et le droit à l’autodétermination. Si la sécurité d’un Israélien est précieuse pour le gouvernement de Tel-Aviv, celle d’un Palestinien ne vaut pas grand-chose à ses yeux.
La défaite de la seconde Intifada, qui a éclaté en septembre 2000, a entraîné un affaiblissement sensible de l’Autorité palestinienne, la division entre Gaza — sous le contrôle du parti islamiste Hamas — et la Cisjordanie — sous celui du Fatah d’Arafat. Sont toutefois intervenus des succès diplomatiques indéniables, comme l’acceptation de la Palestine comme membre observateur des Nations unies et sa reconnaissance diplomatique par une centaine d’États (mais pas la France). Autre accomplissement : la consolidation d’un nationalisme vigoureux qui dépasse les appartenances locales et les expériences multiples de l’exil. Ni les divisions internes ni les efforts israéliens n’ont amené les Palestiniens à résipiscence. Non seulement ils s’accrochent à leurs maisons, mais ils revendiquent fièrement leur identité, sous occupation ou dans l’exil. Aujourd’hui, sur le territoire de la Palestine mandataire, on dénombre, selon le Bureau central palestinien des statistiques, autant de Palestiniens (plus de six millions en comptant ceux d’Israël) que d’Israéliens juifs : un cauchemar pour les dirigeants sionistes qui rêvaient d’une « terre sans peuple » (7).
« Ranimer le processus de paix » relève désormais de l’illusion — sauf aux yeux du président Mahmoud Abbas et de la « communauté internationale », qui voit dans le maintien de son administration sous respiration artificielle une nécessité pour justifier son immobilisme et son absence de proposition innovante fondée sur le droit international. Quelle nouvelle stratégie les Palestiniens adopteront-ils ? Il faudra du temps pour reconstruire un projet ; la page ouverte par la guerre de juin 1967 est définitivement refermée avec l’échec d’Oslo, et le débat les divise. Faut-il abandonner l’idée du partage ? Faut-il revendiquer un seul État ? Faut-il dissoudre l’Autorité palestinienne ? Quelle place doit occuper la violence ? Même le Hamas, réputé pourtant pour sa discipline, n’échappe pas au débat, comme en témoigne son nouveau programme, qui accepte pour la première fois clairement l’idée d’un État dans les frontières de 1967 (8).
La portée symbolique d’un conflit
Mais, comme l’expliquent deux universitaires palestiniennes, « en l’absence de clarté sur la solution politique définitive, les objectifs centraux restent les droits fondamentaux, qui sont les éléments essentiels du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et doivent faire partie de toute solution politique future : la libération de l’occupation et de la colonisation, le droit des réfugiés à retourner dans leurs foyers et à leurs propriétés (9), et la non-discrimination et la pleine égalité des citoyens palestiniens d’Israël. Ces trois objectifs, en tant qu’éléments essentiels de l’autodétermination, sont exposés de manière éloquente dans l’appel de la société civile palestinienne pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS) contre Israël jusqu’à ce que ces objectifs soient atteints (10) ».
Le mouvement BDS, lancé le 9 juillet 2005 à l’appel de 171 organisations non gouvernementales, marque une étape dans l’histoire palestinienne : le relais pris par la société civile face à l’impuissance des forces politiques. Cette mobilisation pacifique pour l’égalité des droits, que certains gouvernements occidentaux, dont celui de la France, tentent de criminaliser, rassemble largement, de l’Amérique latine à l’Asie en passant par l’Europe, comme on a pu le voir durant la guerre de Gaza de l’été 2014. Pourquoi ?

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, deux causes principales ont mobilisé par-delà les frontières : le Vietnam, puis l’Afrique du Sud. Le nombre de morts n’a pas été la cause centrale de ces indignations. L’opinion publique internationale ne mesure pas ses réactions à la seule aune d’une comptabilité macabre ; elle est aussi sensible à la portée symbolique des situations. À un moment donné, un conflit peut déborder le cadre étroit de sa localisation géographique pour acquérir une signification universelle, pour exprimer la vérité d’une époque. Malgré leurs dissemblances, le Vietnam et l’Afrique du Sud se situaient tous deux sur la ligne de faille entre le Nord et le Sud, et ils étaient tous les deux des conflits à dimension coloniale.
C’est aussi le cas de la Palestine ; mais le contexte a changé. Déjà, l’expérience sud-africaine, avec le projet du Congrès national africain (ANC) d’une « société arc-en-ciel » intégrant les Blancs — en opposition aux théories du « pouvoir noir » —, avait révélé un changement d’époque (lire « L’Afrique du Sud lassée de ses libérateurs ») ; la lutte armée n’était plus le chemin unique, des voies nouvelles pouvaient être explorées pour la libération, l’égalité des droits était au centre des revendications.
Avec la Palestine, le conflit le plus long de l’époque contemporaine, nous dépassons le différend purement territorial. Plus qu’une question de sol, c’est avant tout une question de justice, ou plutôt d’injustice sans cesse recommencée. Dans les territoires occupés, la population est confrontée à un phénomène qui a disparu ailleurs : un colonialisme en marche. Depuis 1967, Israël a installé en Cisjordanie et à Jérusalem-Est plus de 650 000 colons, une pratique que la Cour pénale internationale qualifie de « crime de guerre ». La vie quotidienne des Palestiniens est marquée par la confiscation de leurs terres, la destruction de leurs maisons, les arrestations — la majorité de la population adulte masculine est passée par la case prison —, la torture, une armée qui tire à vue, la construction d’un mur qui ne « sépare » pas deux populations mais concourt à enfermer l’une d’elles. Se dessine un archipel de bantoustans (11), contournés par des routes spéciales réservées aux Israéliens — une forme de ségrégation qui n’existait même pas en Afrique du Sud. La population est gouvernée par des lois spéciales, un régime qui ressemble par bien des traits à de l’apartheid : deux populations sur la même terre (Cisjordanie et Jérusalem-Est), Palestiniens et colons, soumis à des législations différentes, passibles de tribunaux distincts (12).

À travers le monde, des millions de personnes ont pu se projeter dans le combat que mènent les Palestiniens. Il renvoie à leur propre révolte contre les discriminations et pour l’égalité des droits. À la figure du Palestinien peuvent s’identifier le jeune des quartiers relégués de l’Occident, l’Indien expulsé de ses terres ou l’Irlandais fier de son combat passé contre le colonialisme britannique. Même si elle est loin de garantir un triomphe dans leur combat, cette solidarité reste l’un des atouts majeurs des Palestiniens et une garantie, au-delà de leur propre détermination, que leur cause demeurera vivante.
Le 2 novembre 1917, lord Arthur James Balfour signait une lettre déclarant que le gouvernement britannique « envisage[ait] favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif [dans une première version, il avait écrit “la race juive”] et emploiera[it] tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif ». « Une nation, résumera plus tard l’écrivain Arthur Koestler, qui combattit aux côtés des organisations sionistes, a solennellement promis à une autre le territoire d’une troisième. » Cette entreprise coloniale a inauguré un long siècle d’instabilité, de guerres, de rancœurs et de haines. Elle a alimenté et alimente toujours toutes les frustrations dans la région (lire « Un foyer d’instabilité »). Résoudre le drame palestinien ne ramènera pas d’un coup la paix ; mais, tant que durera l’occupation, il n’y aura ni paix ni stabilité au Proche-Orient.