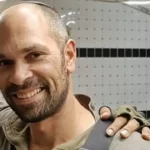«Louanges à Dieu, le tyran a détalé ! » Dans la nuit du 7 au 8 décembre, la rumeur se propage à travers les réseaux sociaux arabes avant même que l’information soit confirmée par des officiels syriens. Le président Bachar Al-Assad a quitté le pays pour une destination inconnue – on apprendra plus tard qu’il s’agit de Moscou. Durant quelques heures, la prudence et le scepticisme le disputent à l’euphorie, même si circulent déjà des images montrant la progression triomphale dans les faubourgs de la capitale de soldats de l’Armée nationale syrienne (ANS) – l’une des deux grandes organisations impliquées dans le renversement de M. Al-Assad avec Hayat Tahrir Al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant). L’incertitude est vite balayée. Après vingt-quatre années et demie de règne impitoyable pour ses opposants, celui qui avait succédé à son père, Hafez – président de 1971 à 2000 –, vient de fuir à la surprise quasi générale. Un nouveau chapitre s’ouvre de l’histoire tourmentée du Proche-Orient. Comprendre les multiples raisons de l’effondrement de ce régime aide à en esquisser les possibles conséquences géopolitiques, dans un contexte marqué entre autres par les tueries massives et les destructions commises à Gaza ou au Liban par l’armée israélienne ainsi que les déroutes du Hezbollah et du Hamas. Sans oublier les brefs affrontements balistiques entre Israël et l’Iran, ou encore les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) en novembre contre le premier ministre Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la défense Yoav Galant pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans l’enclave palestinienne.
L’une des principales causes de la chute de M. Al-Assad tient au pourrissement continu des institutions syriennes. Après avoir maté dans le sang la révolte populaire de 2011, l’ex-président n’a pu empêcher son pays d’abdiquer sa souveraineté en raison des ingérences militaires étrangères, qu’elles soient le fait d’alliés (Russie, Iran, Hezbollah) ou de rivaux sinon d’adversaires (États-Unis, Turquie, Israël) (1). S’y ajoute le contrôle de territoires entiers par des forces paraétatiques – Kurdes dans le Nord, Organisation de l’État islamique (OEI) dans l’Est et coalition djihadiste dans le Nord-Ouest (poche d’Idlib). Ce délitement de l’État syrien s’est traduit, au fil des années, par une débandade au sein des appareils administratif et militaire. La corruption – y compris pour les actes les plus anodins de la vie quotidienne, comme l’inscription d’un enfant à l’école – ainsi que le trafic organisé par des officiers mal payés – qui n’hésitaient pas à revendre des équipements et du carburant sur le marché noir – ont considérablement affaibli un pouvoir incapable de proposer un projet unificateur à ses ressortissants hormis une hypothétique reconquête de tout le territoire national.
Au printemps 2011, face à une contestation pacifique née dans le sillage des révolutions en Tunisie et en Égypte, M. Al-Assad pouvait choisir une autre voie. La guerre civile a fait 500 000 morts et provoqué l’exil de 6 millions de Syriens. Au sein d’une population de 23 millions de ressortissants, il faut aussi mentionner 7 millions de déplacés internes. À bien des égards, le discours prononcé le 30 mars de la même année face au Parlement annonçait la violence et le désordre qui allaient suivre. Aux menaces contre les « fauteurs de troubles », à la dénonciation incantatoire d’une conspiration étrangère répondaient les suppliques flagorneuses et la claque d’élus jurant de sacrifier « leur sang et leur âme » pour sauver non pas leur pays, mais « Bachar le bien-aimé ». Ce clientélisme, la prédation des biens publics par l’entourage de l’ex-président, l’accaparement des avoirs des exilés et des déplacés, l’extorsion et les chantages à la délation, commis par des fonctionnaires ou des membres de forces de sécurité, ont d’autant plus miné le régime que, contrairement à une idée répandue, M. Al-Assad, affaibli par sa sujétion à la Russie et à l’Iran, devait composer avec les ambitions de ses proches, qu’il s’agisse de son frère cadet Maher ou de ses cousins maternels membres du très fortuné clan Makhlouf. Au début des années 1990, dans la Syrie d’Assad père, on dénombrait déjà une dizaine de services de sécurité plus ou moins coordonnés. Trente ans plus tard, on en compte le double. Chaque pan du pouvoir, chaque personnalité de poids dispose de sa propre force, plus ou moins officielle et capable d’enlever n’importe qui ou de croiser le fer avec une structure rivale pour des motifs bassement matériels. La multiplication des sites de production de captagon, drogue euphorisante qui a envahi tout le Proche-Orient, péninsule arabique comprise (2), ne s’explique pas autrement. Source aisée d’enrichissement personnel ou d’acquisition d’armements, ce psychotrope s’est révélé un poison qui a endommagé la cohésion d’un système longtemps présenté comme inoxydable.
Soutien des monarchies arabes
Au vu de la totale désorganisation des forces dites « loyales », la prise d’Alep, le 27 novembre, par une poignée de djihadistes — trois cents au maximum — n’a rien d’extraordinaire. Ce fut le prologue d’un renversement dont la seconde explication tient à l’abandon pur et simple de M. Al-Assad par ses alliés. Pourtant, le régime semblait convaincu d’avoir fait le plus dur en regagnant un certain crédit sur le plan international. En mai 2023, la Syrie faisait son retour au sein de la Ligue arabe après une suspension de douze ans. Soutenu par les monarchies du Golfe, auxquelles il réclamait la prise en charge financière de la reconstruction de son pays, l’ex-président se sentait d’autant plus en confiance que de nombreuses capitales occidentales, dont Rome, annonçaient la réouverture de leur ambassade à Damas afin, entre autres, de pouvoir négocier au plus vite le rapatriement des réfugiés syriens en Europe. Même le numéro un turc Recep Tayyip Erdoğan, l’un des critiques les plus virulents du pouvoir syrien, semblait s’être fait une raison en se disant, à plusieurs reprises, prêt à une rencontre avec son homologue. Lequel répliquait avec sa morgue habituelle qu’aucune discussion n’était possible tant que des troupes turques occupaient le sol syrien. Côté iranien, les soubresauts provoqués par la guerre à Gaza et au Liban renforçaient l’idée que la République islamique avait tout intérêt à continuer de ménager cet allié. Quant à la Russie enlisée en Ukraine, le régime de Damas lui garantissait un accès permanent à la Méditerranée avec les installations navales de Tartous ainsi qu’une amplitude de projection aérienne avec la base de Hmeimim.
Alors pourquoi le régime de M. Al-Assad n’a-t-il pas été sauvé comme il le fut en 2013 par les Iraniens et le Hezbollah ? Pourquoi M. Vladimir Poutine n’a-t-il pas ordonné à son aviation d’intervenir, comme elle le fit en 2015 puis l’année suivante lors de la reconquête sanglante de la ville d’Alep ? La réponse relève du triptyque contexte, volonté et moyens. Depuis février 2022, une guerre d’usure en Ukraine mobilise la quasi-totalité des moyens conventionnels et des effectifs de l’armée russe. En détourner une partie vers la Syrie revenait à s’affaiblir alors même que les Occidentaux et Kiev tentent coûte que coûte de modifier le rapport de forces avant les négociations que le président élu Donald Trump entend imposer aux belligérants dès sa prise de fonctions. Depuis au moins deux ans, du reste, les Russes s’impatientaient de l’incapacité de M. Al-Assad à stabiliser son pays et, surtout, à engager de vraies négociations tant avec la coalition djihadiste qui tenait la poche d’Idlib qu’avec les Kurdes du Rojava. Tout cela a plaidé contre une intervention, malgré les demandes pressantes de l’ex-président syrien. Certes, la majorité des médias internationaux n’ont pas manqué de pointer un revers majeur pour Moscou. Mais la Russie a sans doute limité les dégâts notamment grâce à ses négociations avec la Turquie, marraine d’une partie des insurgés. Dans le tumulte qui a suivi la « libération » de Damas, les représentations diplomatiques russes n’ont pas été attaquées, contrairement à celles de l’Iran. De son côté, M. Ahmed Al-Charaa (de son nom de guerre Abou Mohammad Al-Joulani), chef de HTC et nouvel homme fort de la Syrie, a soigneusement évité de s’en prendre au protecteur du dictateur déchu, acceptant même de recevoir des émissaires dépêchés par M. Poutine. L’avenir dira si les bases de Tartous et de Hmeimim resteront dans le giron russe mais, à coup sûr, Moscou dépend plus que jamais d’Ankara sur le théâtre syrien.

Un pays recomposé
Un raisonnement semblable vaut au sujet de l’Iran. Les autorités de la République islamique ne ménageaient pas non plus leurs critiques contre M. Al-Assad. En décembre 2018, déjà, circulaient des informations selon lesquelles elles souhaitaient un changement à la tête de la Syrie. Comme Téhéran pouvait alors invoquer son soutien financier, évalué à 5 milliards de dollars par an depuis 2012, l’ex-président se rendit en Iran en février 2019 — sa première visite chez son allié depuis 2010 — afin de plaider sa cause et de donner des gages au Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Mais, en 2024, les Iraniens n’ont pas cédé : bien qu’ils eussent préféré un ripolinage à l’évincement de leur allié alaouite — une confession proche du chiisme —, M. Al-Assad a fini par lasser ses interlocuteurs, qui se sont empressés de reconnaître son renversement. Les coups portés par l’armée israélienne au Hezbollah ont aussi empêché Téhéran d’actionner ses relais dans la région. Et, même s’il en avait eu la possibilité humaine et matérielle, le parti libanais ne pouvait se porter au secours du régime syrien. Comment le justifier après tant de morts parmi ses
chefs et militants, et tandis que la population libanaise demeure traumatisée par les attaques israéliennes ? Ne restait que la possibilité de mobiliser des moyens iraniens, sachant que Téhéran dispose d’une faible capacité d’action aérienne, indispensable pour freiner l’avancée de forces insurgées. Or, comme en témoignent les éditoriaux bellicistes de la presse conservatrice iranienne, au plus haut niveau de la République islamique on estime qu’Israël arrivera à convaincre M. Trump de la nécessité d’une attaque contre les installations nucléaires, voire d’une guerre à plus grande échelle afin de précipiter un changement de régime à Téhéran. La peur de la déstabilisation n’est pas nouvelle : apparue dès les premiers mois ayant suivi la chute du chah en 1979, elle façonne les doctrines de défense iraniennes ; dès lors, gaspiller une partie de ses ressources pour sauver un allié peu enclin à améliorer sa propre situation devenait contre-productif.
L’« arc chiite » est brisé
Mais, comme pour la Russie, la chute de M. Al-Assad constitue un échec pour l’Iran, qui a dépensé à fonds perdu afin de le soutenir, sans oublier les milliers de morts de gardiens de la révolution et de membres de milices chiites. Des communautés chiite, à Damas et au nord d’Alep, et alaouite, sur la côte méditerranéenne et à Damas également, demeurent dans le pays, mais la seconde n’a plus le pouvoir, qui échoit pour l’instant à d’anciens djihadistes, ou proclamés tels, d’obédience sunnite. L’« arc chiite », qui reliait l’Iran au Liban via l’Irak et la Syrie, s’en trouve brisé. Pour nombre de radicaux sunnites, le combat contre l’hérésie chiite prime, avant même de songer à retourner ses armes contre d’autres ennemis, dont Israël. M. Al-Charaa a beau affirmer à la presse étrangère qu’il ne veut aucune guerre, il lui reste à convaincre ses pairs de ne pas déclencher de crise avec Téhéran. Outre la question de la dette extérieure (Damas devrait 50 milliards de dollars à son protecteur, une facture concernant essentiellement des livraisons de carburant et d’armements), se pose aussi celle des intérêts économiques privés, comme les commerces du souk de Damas détenus par des hommes d’affaires venus d’Iran. La population damascène favorable au nouveau pouvoir a déjà exprimé un sentiment anti-iranien très vif. Des tensions pourraient apparaître dans les prochains mois entre les deux pays.
L’Irak devient de fait la défense avancée de l’Iran sur le plan régional. Au cours des prochains mois, Téhéran continuera d’y renforcer son influence, déjà grande. Les États-Unis avaient mis en garde le gouvernement central de Bagdad en janvier 2024 contre l’essor grandissant des milices pro-iraniennes — et par conséquent antiaméricaines — qui tendent à constituer un État dans l’État (3). Le recentrage irakien de Téhéran devrait provoquer de nouvelles tensions à ce sujet, et il n’est pas exclu que ces milices, dont la constitution remonte à l’époque où les troupes de l’OEI menaçaient de marcher sur Bagdad, se montrent plus actives à la frontière syro-irakienne pour prévenir d’éventuelles infiltrations djihadistes.
La Turquie elle, fait figure de grande vainqueure sur l’échiquier syrien. En 2020, c’est une négociation russo-turque qui a permis d’éviter une défaite totale aux troupes de HTC réfugiées dans la poche d’Idlib. M. Al-Assad pensait en finir rapidement avec cette dernière composante de la rébellion… qui aujourd’hui détient le pouvoir à Damas, même si elle doit composer avec d’autres organisations. Ankara a ainsi l’avantage de pouvoir traiter avec un interlocuteur redevable. La question des réfugiés syriens en Turquie fait partie des dossiers les plus urgents. Au nombre de trois millions, ces exilés constituent un vrai problème de politique intérieure pour M. Erdoğan, qui souhaite leur retour rapide en Syrie. Dès le 9 décembre, avant même le moindre accord en ce sens, les autorités turques ont ordonné la réouverture d’un poste-frontière.
S’il est vraisemblable que de nombreux réfugiés prendront le chemin de leurs foyers, les questions territoriales devraient s’avérer plus difficiles à régler, sauf à obliger M. Al-Charaa à apparaître comme le jouet servile d’Ankara. Non seulement l’armée turque occupe plusieurs pans du territoire syrien, mais elle se prépare à attaquer la région quasi autonome du Rojava pour en déloger les forces kurdes des Unités de protection du peuple (YPG, branche armée du Parti de l’union démocratique) (4). Quelle sera alors l’attitude de Damas, dont l’homme fort a pris l’engagement de négocier pacifiquement avec les autonomistes ? Et celle des États-Unis, alliés des Kurdes dans la guerre contre l’OEI, après l’investiture de M. Trump ? Lors de sa première présidence, en octobre 2019, l’intéressé avait fait peu de cas des obligations américaines à l’égard de ce peuple qui ne dispose toujours pas d’un État en affirmant, à tort, que les Kurdes n’avaient « pas aidé les États-Unis durant la seconde guerre mondiale ». Avec près de deux mille hommes stationnés dans le nord-est de la Syrie, Washington empêche pour l’heure la Turquie d’attaquer le Rojava, mais rien ne dit que l’incertitude engendrée par la chute du régime de M. Al-Assad n’incitera pas M. Erdoğan à tenter d’en finir…
Nombre des conjectures qui précèdent dépendent aussi de la nature réelle du pouvoir qui s’installe à Damas. Longtemps affiliés à la mouvance djihadiste, autrement dit des combattants de la foi qui estiment que les frontières et les projets nationaux doivent s’effacer devant la constitution d’un califat, les membres de HTC revendiquent aujourd’hui un credo « nationalisto-religieux » et une rupture définitive avec des organisations telles qu’Al-Qaida ou l’OEI. Les références à la charia demeurent mais, pour M. Al-Charaa, il s’agit de ne s’occuper que de la Syrie. Ce recentrage idéologique, mais aussi théologique, fait l’objet de débats chez les spécialistes des courants islamistes. Faut-il croire le chef de HTC quand il promet de respecter les droits des minorités religieuses — notamment ceux des chrétiens de Syrie, passés de 8 % à 2 % de la population en dix ans ? Faut-il lui accorder crédit quand il assure avoir pris ses distances avec le djihad global dont se prévalent les auteurs d’attentats en de multiples endroits de la planète ? La gestion de la poche d’Idlib, où cohabitaient de multiples communautés, a en tout état de cause poussé M. Al-Charaa à plus de pragmatisme et à opérer une déradicalisation certaine, voire à se « désalafiser » (5). L’avenir dira si cette expérience est extensible à l’échelon national. Pour l’heure, les puissances occidentales semblent d’autant plus prêtes à faire confiance à HTC que ses dirigeants demeurent très vagues quant à leurs intentions à l’égard d’Israël, qui occupe pourtant une partie du territoire syrien tout en le bombardant de manière régulière (lire « Israël pousse frénétiquement ses pions »).
Au fond se repose la question de la capacité d’un mouvement islamiste à diriger un pays en respectant les règles de la démocratie et les libertés individuelles. Dans la majorité des cas, les formations de ce type — pourtant porteuses d’aspirations populaires, comme en témoignent leurs scores électoraux élevés — ont brutalement été éjectées du pouvoir. Ce dont témoignent les cas algérien (1992), égyptien (2013) ou tunisien (2021). Mais qui pourrait démettre M. Al-Charaa et son mouvement ? Purgée de ses éléments les plus compromis dans le soutien à M. Al-Assad, l’armée devrait se restructurer et intégrer des milices, dont celle affiliée à HTC, ce qui relativise le risque de coup d’État de sa part. Sur le plan politique, et en dehors de la sphère islamiste, HTC et ses alliés n’ont guère de rivaux. Jadis omniprésent, le parti Baas (« Parti de la renaissance » en arabe) n’est plus qu’une coquille vide, l’emblème de la dictature des Al-Assad, le tenant d’un panarabisme auquel plus personne ne croit. Le danger ne peut venir que d’une surenchère islamiste. Dans l’Est, l’OEI n’a pas disparu. Elle constitue toujours une menace et une force d’attraction pour les éléments les plus radicaux qui se détournent du pragmatisme de HTC.
La Syrie va donc constituer un champ d’expérimentations multiples. Celle de la nécessaire reconstitution d’un État. Celle de la création d’une nouvelle armée. Et celle de l’arrivée au pouvoir d’islamistes encore inscrits sur les listes internationales de djihadistes à arrêter, qui, s’ils étaient palestiniens, libanais ou soudanais, seraient, aujourd’hui encore, voués aux gémonies par les pays et les médias occidentaux.