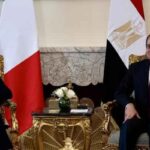Treize ans après le déclenchement du soulèvement contre le régime Assad, la tragédie syrienne laisse toujours indifférent. En comparaison, le martyre infligé par Israël aux Palestiniens donne lieu en Occident à une mobilisation importante d’une partie de la société civile.
OLJ / Par Soulayma MARDAM BEY,
Il n’y a pas eu de grande mobilisation internationale. Ni cette année ni celle d’avant. Malgré les centaines de milliers de morts, de disparus, de torturés. Malgré les millions de réfugiés, de déplacés internes et d’exilés. Malgré les sièges d’Alep, de la Ghouta et d’Idleb. Treize ans après le déclenchement du soulèvement syrien le 15 mars 2011, le constat est le même qu’il y a un an, qu’il y a trois ans, qu’il y a dix ans. Par désintérêt ou choix politique, la tragédie syrienne ne suscite toujours pas de grands élans d’empathie aux quatre coins du monde, alors même que le monde entier s’est progressivement retrouvé en Syrie : la Russie et l’Iran ; la Turquie et Israël ; la coalition internationale contre l’État islamique ; miliciens chiites et jihadistes sunnites de toutes les nationalités possibles et imaginables. Le principal responsable de la situation a un nom et un visage. Il s’appelle Bachar el-Assad. Et il n’a su répondre aux aspirations de son peuple que de la seule manière qu’il connaisse : la mort, la destruction, le chaos.
En comparaison, la folie meurtrière d’Israël – qui depuis l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre atteint des sommets inégalés – suscite colère et réprobation auprès de franges importantes des opinions publiques mondiales. On manifeste, on bloque les universités, on arbore des drapeaux palestiniens dans les mouvements sociaux, on appelle au boycott. Une partie des électeurs du Parti démocrate aux États-Unis menace de s’abstenir au scrutin présidentiel à venir pour protester contre le soutien politique et militaire indéfectible de Joe Biden – rebaptisé « Genocide Joe » – à l’État hébreu.
Pourtant, le régime sioniste et le régime Assad ont recours à des méthodes similaires : bombardements indiscriminés, incarcération massive, torture et mauvais traitements, siège des villes et des villages et volonté affichée de chasser la population pour recoloniser le territoire dans le cas israélien, pour récupérer un pays utile débarrassé de ses « classes dangereuses » dans le cas syrien. Et pour attirer la sympathie d’une partie des Occidentaux, l’un et l’autre ont eu recours à une rhétorique de défense de la « civilisation » face au « terrorisme ».
Pour comprendre ce décalage dans la réception de ces deux catastrophes politiques et humanitaires, plusieurs raisons peuvent être invoquées. La première est d’ordre temporel. Cela fait plus de 75 ans que le peuple palestinien subit les stratégies israéliennes visant à l’expulser de chez lui. Si l’on préfère remonter à la déclaration Balfour (1917) ou au premier congrès sioniste mondial (1897), la question est même vieille de plus d’un siècle. Certes, cette longévité enfante une forme de lassitude. Elle donne l’impression que le sujet est insoluble et qu’il faut « faire avec ». Mais au gré du temps, l’émergence d’un contre-récit palestinien dans des sociétés occidentales longtemps dominées par le son de cloche sioniste libéral a contribué à changer la donne. Et l’accumulation des blancs-seings accordés à Israël par les gouvernements occidentaux a nourri un fort sentiment de ras-le-bol au sein d’une partie de leurs populations. Une émotion renforcée par la charge symbolique du lieu. De par son histoire et l’imaginaire qu’elle convoque, la Terre sainte est évidemment plus propice aux passions.
Fossé
L’essentiel est cependant ailleurs. Le bien mal-nommé « conflit » israélo-palestinien permet de raviver à gauche et dans les milieux antiracistes une grille de lecture anti-impérialiste Nord-Sud qui rappelle les grandes luttes anticoloniales d’hier. Pour certains, la guerre en Syrie – aussi terrible soit-elle – est apparue comme une affaire interne au monde arabe, qui du fait du jeu des puissances s’est transformée en conflit international. Sans compter les conséquences désastreuses des invasions de l’Afghanistan et de l’Irak à l’orée des années 2000 qui ont rendu nombre d’Européens et d’Américains circonspects face aux discours fondés sur la défense de la « liberté » contre « l’obscurantisme » ou la « dictature ».
En revanche, la question palestinienne est intrinsèquement liée à l’histoire de l’Europe, le continent qui a théorisé l’antisémitisme et mis en œuvre la Shoah d’une part, qui s’est partagé l’Orient arabe sur les ruines de l’Empire ottoman de l’autre. C’est à Bâle, en Suisse, que s’est déroulé le premier congrès sioniste mondial. Theodor Herzl était austro-hongrois. Ben Gourion est né à Plonsk, Golda Meir à Kiev. Lord Balfour lui-même a accueilli favorablement l’établissement d’un foyer national juif en Palestine dans le but antisémite d’atténuer selon lui « les misères séculaires créées pour la civilisation occidentale par la présence en son sein d’un corps qu’elle a trop longtemps considéré comme étranger et même hostile ». Les racines intellectuelles, idéologiques et politiques du sionisme sont européennes. Et de ce fait, l’Europe a une responsabilité historique dans le drame palestinien. Dans ces circonstances, s’emparer de la question syrienne donne à certains l’impression de se mêler de ce qui ne les regarde pas, quand militer pour la Palestine revient en somme à balayer devant sa porte.
Le fossé Syrie-Palestine au sein des opinions publiques n’est ainsi que le miroir inversé d’un fossé similaire au sein des gouvernements et de nombreux médias. Certes, Bachar el-Assad est parvenu à séduire l’extrême droite, par définition hostile à la démocratie, et une partie de la gauche radicale grâce à son jargon anti-impérialiste. Mais par paradigme libéral dominant, la voix de l’opposition syrienne a pu parfois trouver des échos favorables dans certains cercles du pouvoir et de la presse. L’UE tout comme les États-Unis ont voté des sanctions contre le régime Assad. Ils en ont fait de même contre son protecteur russe, après l’annexion de la Crimée en 2014 et l’invasion de l’Ukraine en 2022. Ce n’est pas le cas avec Israël. Bien au contraire. Après le 7 octobre – comme à l’accoutumée mais avec plus d’entrain –, les principaux leaders occidentaux se sont pressés au chevet de l’État hébreu et ont fait la sourde oreille lors des sorties génocidaires de ses dirigeants. Des événements en présence d’artistes et d’écrivains palestiniens ont été annulés. Des mobilisations propalestiniennes ont été interdites. L’aide à l’Unrwa a été mise en suspens.
Crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le monde ne sont pas l’apanage d’Israël. Mais Israël est le seul État au monde qui bénéficie d’une éternelle impunité de la part des Occidentaux, pourtant les premiers à invoquer les droits humains quand cela leur est profitable. Militer pour la Palestine revient alors à faire pression sur son propre gouvernement, à critiquer ses propres médias.
Certes, une partie des militants les plus actifs dans cette mobilisation se sont distingués auparavant – sous des prétextes géopolitiques – par un soutien plus ou moins assumé à Damas, Moscou ou encore Téhéran. Les écouter à présent évoquer avec gravité les horreurs infligées aux Palestiniens peut légitimement exaspérer. Le fait est cependant qu’en matière de campisme, ils sont aujourd’hui rejoints par de nombreux libéraux qui avaient condamné par le passé Assad et Poutine et qui se rangent désormais derrière Israël. En matière de « deux poids, deux mesures», les uns rivalisent avec les autres.
« Ce que Assad a fait en quelques années, même Israël n’en a pas été capable depuis la Nakba. » Au cours de la décennie précédente, dans certains cercles intellectuels, beaucoup en étaient arrivés à ce constat lugubre. Au-delà des limites d’une telle comparaison – malgré des similitudes évoquées plus haut, colonialisme de peuplement d’une part et despotisme de l’autre répondent à des logiques différentes –, la vérité est que l’entreprise meurtrière israélienne relève aujourd’hui du jamais-vu dans une région pourtant habituée à l’écrasement de la dignité humaine. En cinq mois seulement, l’État hébreu a tué plus de 31 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. Parmi eux, près de 12 300 sont des enfants. Mais à quoi bon se livrer à ces décomptes sinistres ? Une injustice est une injustice. Quelle que soit l’identité de l’oppresseur, quelle que soit celle de l’opprimé.